Mirabeau. Des lettres de cachet et des prisons d’État, 1782.
Guy Chaussinand-Nogaret, Mirabeau, Seuil, 1982.
Partie 1. Biographie résumée. Source : extraits d’un article de Wikipédia.
« Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, plus communément appelé Mirabeau, né le 9 mars 1749 à Bignon-Mirabeau et mort le 2 avril 1791 à Paris, est un écrivain, diplomate, journaliste et homme politique, figure de la Révolution.
Surnommé l’Orateur du peuple et la Torche de Provence, il reste le premier symbole de l’éloquence parlementaire en France. Bien que membre de la noblesse, il se distingue en tant que député du Tiers état aux États généraux après avoir été rejeté par l’ordre de la noblesse.
Fort aimé par les révolutionnaires, son corps est transporté au Panthéon à sa mort, mais la découverte de ses relations secrètes avec la royauté retourne l’opinion, et sa dépouille est retirée du mausolée, dont il était le premier occupant.
En 1774 (Mirabeau a 25 ans), son père demande son emprisonnement au château d’If, au large de Marseille, pour le remettre dans le droit chemin, emprisonnement qui durera près d’un an.
Pour le soustraire à ses créanciers, son père le fait plusieurs fois enfermer au donjon de Vincennes, et finalement exiler en 1775 au château de Joux, en Franche-Comté. Là, Mirabeau use de son charme auprès du gouverneur pour se rendre de nombreuses fois à Pontarlier : à l’occasion des fêtes organisées pour le sacre de Louis XVI, il y rencontre Sophie de Monnier, jeune femme mariée au marquis de Monnier, président de la chambre des comptes de Dole et près de cinq ans son aîné.

Sophie devient la maîtresse de Mirabeau et ils s’enfuient tous deux aux Provinces-Unies, tandis qu’on les juge à Pontarlier par contumace (Sophie sera condamnée à l’enfermement à vie dans une maison de repentance pour crime d’adultère, Mirabeau à mort pour rapt et séduction).
1776. Durant sa fuite, Mirabeau publie son Essai sur le despotisme, qui dénonce l’arbitraire du pouvoir royal : le despotisme n’est pas une forme de gouvernement […] s’il en était ainsi, ce serait un brigandage criminel et contre lequel tous les hommes doivent se liguer.
1778. Les deux amants seront rattrapés à Amsterdam : Sophie arrêtée, Mirabeau se livrera. Après avoir mis au monde une fille, prénommée Gabrielle Sophie, elle est condamnée à être enfermée au couvent des Saintes-Claires, à Gien, où elle est effectivement conduite en 1778.
Lui échappe au bourreau, mais retourne, à cause d’une autre lettre de cachet, au donjon de Vincennes, durant quarante-deux mois. Gabrielle Sophie sera confiée à une nourrice de Deuil et décédera en 1780 sans que son père n’ait jamais pu la connaître.
De 1777 à 1780. Mirabeau est donc emprisonné au donjon de Vincennes. Il y rencontre Sade, qui y est enfermé à la même époque.
1782. Il y écrit beaucoup : des lettres, notamment à Sophie de Monnier, publiées en 1792 sous le titre de Lettres à Sophie, chef-d’œuvre de la littérature passionnée,
Les décès coup sur coup de ses deux seuls petits-enfants, Victor et Gabrielle Sophie, adoucissent Mirabeau père, qui ne souhaite pas que sa lignée s’éteigne. Il accepte de faire libérer son fils aîné, à condition de détenir une autre lettre de cachet qui pourrait le renvoyer en prison : Mirabeau fils accepte la condition, et doit lui-même écrire aux ministres pour appuyer la requête paternelle.
Mirabeau est donc libéré le 13 décembre 1780, mais reste sous la tutelle vigilante de son père. Celui-ci le force notamment à demander une lettre de cachet contre Briançon, un de ses anciens amis, et surtout à le soutenir contre sa propre mère, en procès contre son mari au sujet de son héritage.
En 1781, Mirabeau fuit Paris et ses créanciers ; il se rend à Gien, où il voit Sophie dans son couvent, mais repart bientôt et ne la reverra plus. Sophie, bien que libre en 1783, après le décès du marquis de Monnier, restera près du couvent de Gien, et se donnera la mort en 1789.
Se réconciliant avec son père, qui commence à voir en lui la puissance politique et l’intelligence, Mirabeau se concentre désormais sur l’absolution de ses différentes condamnations. S’il ne purge pas sa peine avant mai 1782, il devra 40 000 livres de dommages et intérêts ; il se livre donc le 8 février 1782 à Pontarlier, et demande l’absolution aux juges. Sa défense est assez simple : une femme mariée ne peut être victime de rapt, et Sophie l’a suivi parfaitement librement, la séduction ne pouvant donc être retenue.
Sa femme demande la séparation de corps en 1782 et est défendue par Portalis. Mirabeau défend sa propre cause dans ce procès qui défraie la chronique. Il le perd, après une joute oratoire assez hostile entre les deux orateurs. Elle obtient la séparation de corps en juillet 1783. Mirabeau ne montre pas de ressentiment à l’encontre de Portalis car, non seulement il reconnaît publiquement ses qualités oratoires et sa loyauté, mais, de surcroît, il le consultera plus tard sur une affaire et demandera son appui lors de la campagne électorale de 1789 pour les États généraux, en Provence ».
Mirabeau par le sculpteur Injalbert, musée Fayet, Béziers

Partie 2. Libelle contre l’arbitraire de la justice de son temps, Des Lettres de cachet et des prisons d’État en 1782.







































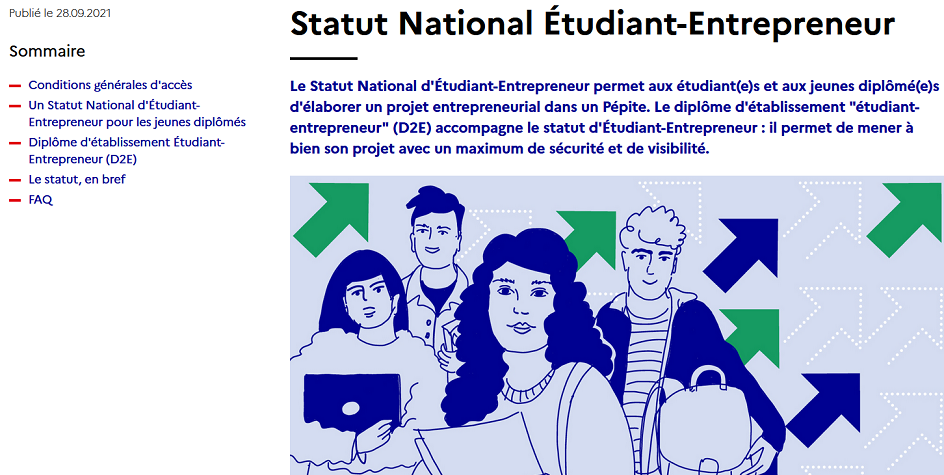

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.