Stéphane Loire, Peintures italiennes du 18ème siècle du musée du Louvre, Gallimard, 2017, 576 pages. Source : Éditions du Louvre.
« Le musée du Louvre conserve un ensemble exceptionnel de peintures du Settecento, réunies pour la plupart dans la seconde moitié du 20ème siècle. Après deux volumes consacrés aux peintures italiennes du 17ème siècle du musée du Louvre (1996, 2006), cet ouvrage vient compléter la publication du catalogue raisonné du fonds de peinture baroque italienne du musée du Louvre. Il prend en compte, selon des principes identiques, les tableaux de tous les foyers régionaux présents dans les collections (Bologne, Florence, Gênes, Lombardie, Naples, Rome et Venise), dus à des artistes nés entre 1655 et 1754.
Chaque peinture fait l’objet d’une étude aussi complète que possible permettant d’établir un bilan des connaissances sur ce magnifique ensemble. On y trouvera ainsi des notices détaillées pour 187 tableaux conservés au musée du Louvre, auxquels viennent s’ajouter 151 autres déposés hors du musée ».
La peinture italienne au Louvre. Une visite guidée. Aline François-Colin, 2000, 40 pages.
« Ce guide permet de se familiariser avec l’histoire de la peinture en Italie du XIIIe au XVIIIe siècle, constituée de différentes écoles artistiques régionales (Florence, Venise, Rome et Naples…). Un choix de trente-quatre tableaux nous mène à la rencontre des plus grands artistes, du peintre florentin Cimabue au Vénitien Tiepolo ».
11 biographies
Vers 1700. Pasqualino Rossi (Vicence 1641 – Rome 1722). La maitresse d’école.

Vers 1709. Francesco Trevisani (Capodistria 1656 – Rome 1746). Le sommeil de l’Enfant Jésus.

Vers 1710. Alessandro Magnasco (Gênes, 1667-1749). Les muletiers dit aussi paysage au château.

Vers 1715. Alessandro Magnasco (Gênes, 1667-1749). La tentation de Saint Antoine.

Vers 1723. Giambattista Pittoni (Venise, 1687-1767). Suzanne et les vieillards.

Vers 1730. Giovanni Battista Busiri (Rome, 1698-1757). Le village et les cascades de Tivoli.

Vers 1736-1737. Gianantonio Pellegrini (Venise, 1675-1741). La Lutte entre l’Allemagne et la France pour la conquête du Rhin.

Vers 1740. Pietro Longhi (Venise, 1701-1785). La présentation.

1743. Giovanni Paolo Panini (Plaisance, 1691 – Rome, 1765). Ruines d’architecture avec l’arc de Janus, le temple de Vesta et la statue équestre de Marc Aurèle.
























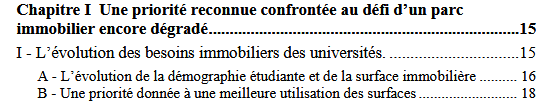


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.