1750. Rousseau. Le discours rebelle
Prix de l’Académie de Dijon en l’année 1750 sur la Question proposée par la même Académie :
Si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs.
Rousseau répond négativement à la question et obtient le Prix. Le succès de librairie est foudroyant. Mais des flots de critiques se déversent sur l’auteur, Siècle des Lumières et Encyclopédie obligent.
Partie 1. Discours sur les Sciences et les Arts. Source : texte intégral dans Les Échos du Maquis, v. 1,0, avril 2011.
NOTE SUR CETTE ÉDITION
« Texte intégral du Discours qui valut à Rousseau le prix de l’Académie de Dijon en 1750. Le manuscrit de la version originale de ce texte a disparu. Le Discours tel qu’on le connaît est basé sur une version corrigée plus tard par Rousseau et destinée à une éventuelle édition des Œuvres complètes. Dans la Préface, l’auteur rend compte de ce qui peut distinguer cette nouvelle version de la première.
Rousseau ajoute également, lors de la réalisation de cette version corrigée, un Avertissement, qui se lit ainsi: Qu’est-ce que la célébrité? Voici le malheureux ouvrage à qui je dois la mienne. Il est certain que cette pièce qui m’a valu un prix et qui m’a fait un nom est tout au plus médiocre et j’ose ajouter qu’elle est une des moindres de tout ce recueil. Quel gouffre de misères n’eût point évité l’auteur, si ce premier livre n’eût été reçu que comme il méritait de l’être? Mais il fallait qu’une faveur d’abord injuste m’attirât par degrés une rigueur qui l’est encore plus.
PRÉFACE
« Voici une des grandes et belles questions qui aient jamais été agitées. Il ne s’agit point dans ce Discours de ces subtilités métaphysiques qui ont gagné toutes les parties de la littérature, et dont les programmes d’Académie ne sont pas toujours exempts; mais il s’agit d’une de ces vérités qui tiennent au bonheur du genre humain.
Je prévois qu’on me pardonnera difficilement le parti que j’ai osé prendre. Heurtant de front tout ce qui fait aujourd’hui l’admiration des hommes, je ne puis m’attendre qu’à un blâme universel; et ce n’est pas pour avoir été honoré de l’approbation de quelques sages que je dois compter sur celle du public: aussi mon parti est-il pris; je ne me soucie de plaire ni aux beaux esprits, ni aux gens à la mode. Il y aura dans tous les temps des hommes faits pour être subjugués par les opinions de leur siècle, de leur pays, de leur société: tel fait aujourd’hui l’esprit fort et le philosophe, qui par la même raison n’eût été qu’un fanatique du temps de la Ligue. Il ne faut point écrire pour de tels lecteurs, quand on veut vivre au-delà de son siècle.
Un mot encore, et je finis. Comptant peu sur l’honneur que j’ai reçu, j’avais, depuis l’envoi, refondu et augmenté ce Discours, au point d’en faire, en quelque manière, un autre ouvrage; aujourd’hui, je me suis cru obligé de le rétablir dans l’état où il a été couronné. J’y ai seulement jeté quelques notes et laissé deux additions faciles à reconnaître, et que l’Académie n’aurait peut-être pas approuvées. J’ai pensé que l’équité, le respect et la reconnaissance exigeaient de moi cet avertissement ».
EXORDE
« Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs? Voilà ce qu’il s’agit d’examiner. Quel parti dois-je prendre dans cette question? Celui, Messieurs, qui convient à un honnête homme qui ne sait rien, et qui ne s’en estime pas moins. »Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs? Voilà ce qu’il s’agit d’examiner. Quel parti dois-je prendre dans cette question? Celui, Messieurs, qui convient à un honnête homme qui ne sait rien, et qui ne s’en estime pas moins.
Il sera difficile, je le sens, d’approprier ce que j’ai à dire au tribunal où je comparais. Comment oser blâmer les sciences devant une des plus savantes compagnies de l’Europe, louer l’ignorance dans une célèbre Académie, et concilier le mépris pour l’étude avec le respect pour les vrais savants? J’ai vu ces contrariétés; et elles ne m’ont point rebuté. Ce n’est point la science que je maltraite, me suis-je dit, c’est la vertu que je défends devant des hommes vertueux. La probité est encore plus chère aux gens de bien que l’érudition aux doctes. Qu’ai-je donc à redouter? Les lumières de l’Assemblée qui m’écoute? Je l’avoue; mais c’est pour la constitution du discours, et non pour le sentiment de l’orateur. Les souverains équitables n’ont jamais balancé à se condamner eux-mêmes dans des discussions douteuses; et la position la plus avantageuse au bon droit est d’avoir à se défendre contre une partie intègre et éclairée, juge en sa propre cause.
À ce motif qui m’encourage, il s’en joint un autre qui me détermine: c’est qu’après avoir soutenu, selon ma lumière naturelle, le parti de la vérité, quel que soit mon succès, il est un prix qui ne peut me manquer: je le trouverai dans le fond de mon cœur »…
Pages 10 et 11. « Telle est la pureté que nos mœurs ont acquise. C’est ainsi que nous sommes devenus gens de bien. C’est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage. J’ajouterai seulement une réflexion; c’est qu’un habitant de quelque contrée éloignée qui chercherait à se former une idée des mœurs européennes sur l’état des sciences parmi nous, sur la perfection de nos arts, sur la bienséance de nos spectacles, sur la politesse de nos manières, sur l’affabilité de nos discours, sur nos démonstrations perpétuelles de bienveillance, et sur ce concours tumultueux d’hommes de tout âge et de tout état qui semblent empressés depuis le lever de l’aurore jusqu’au coucher du soleil à s’obliger réciproquement; c’est que cet étranger, dis-je, devinerait exactement de nos mœurs le contraire de ce qu’elles sont.
Où il n’y a nul effet, il n’y a point de cause à chercher: mais ici l’effet est certain, la dépravation réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. Dira-t-on que c’est un malheur particulier à notre âge? Non, Messieurs; les maux causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que le monde. L’élévation et l’abaissement journalier des eaux de l’océan n’ont pas été plus régulièrement assujettis au cours de l’astre qui nous éclaire durant la nuit que le sort des mœurs et de la probité au progrès des sciences et des arts. On a vu la vertu s’enfuir à mesure que leur lumière s’élevait sur notre horizon, et le même phénomène s’est observé dans tous les temps et dans tous les lieux »….
Page 15. « Peuples, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science, comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant; que tous les secrets qu’elle vous cache sont autant de maux dont elle vous garantit, et que la peine que vous trouvez à vous instruire n’est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers; ils seraient pires encore, s’ils avaient eu le malheur de naître savants »…
Pages 17 et 18. « Que de dangers! que de fausses routes dans l’investigation des sciences? Par combien d’erreurs, mille fois plus dangereuses que la vérité n’est utile, ne faut-il point passer pour arriver à elle? Le désavantage est visible; car le faux est susceptible d’une infinité de combinaisons; mais la vérité n’a qu’une manière d’être. Qui est-ce d’ailleurs, qui la cherche bien sincèrement? même avec la meilleure volonté, à quelles marques est-on sûr de la reconnaître? Dans cette foule de sentiments différents, quel sera notre criterium pour en bien juger ?
Et ce qui est le plus difficile, si par bonheur nous la trouvons à la fin, qui de nous en saura faire un bon usage?
Si nos sciences sont vaines dans l’objet qu’elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu’elles produisent. Nées dans l’oisiveté, elles la nourrissent à leur tour; et la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu’elles causent nécessairement à la société. En politique, comme en morale, c’est un grand mal que de ne point faire de bien; et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux en saura faire un bon usage? »
Pages 26 et 27. « Mais si le progrès des sciences et des arts n’a rien ajouté à notre véritable félicité; s’il a corrompu nos mœurs, et si la corruption des mœurs a porté atteinte à la pureté du goût, que penserons-nous de cette foule d’auteurs élémentaires qui ont écarté du temple des Muses les difficultés qui défendaient son abord, et que la nature y avait répandues comme une épreuve des forces de ceux qui seraient tentés de savoir? Que penserons-nous de ces compilateurs d’ouvrages qui ont indiscrètement brisé la porte des sciences et introduit dans leur sanctuaire une populace indigne d’en approcher, tandis qu’il serait à souhaiter que tous ceux qui ne pouvaient avancer loin dans la carrière des lettres, eussent été rebutés dès l’entrée, et se fussent jetés dans les arts utiles à la société. Tel qui sera toute sa vie un mauvais versificateur, un géomètre subalterne, serait peut-être devenu un grand fabricateur d’étoffes. Il n’a point fallu de maîtres à ceux que la nature destinait à faire des disciples. Les Vérulam, les Descartes et les Newton, ces précepteurs du genre humain n’en ont point eu eux-mêmes, et quels guides les eussent conduits jusqu’où leur vaste génie les a portés? Des maîtres ordinaires n’auraient pu que rétrécir leur entendement en le resserrant dans l’étroite capacité du leur. C’est par les premiers obstacles qu’ils ont appris à faire des efforts, et qu’ils se sont exercés à franchir l’espace immense qu’ils ont parcouru. S’il faut permettre à quelques hommes de se livrer à l’étude des sciences et des arts, ce n’est qu’à ceux qui se sentiront la force de marcher seuls sur leurs traces, et de les devancer. C’est à ce petit nombre qu’il appartient d’élever des monuments à la gloire de l’esprit humain ».
Partie 2. Autre version intégrale du Discours sur les Sciences et les Arts. Libretti, Le Livre de poche, 2021, 93 pages. Édition présentée et annotée par Jacques Berchtold.

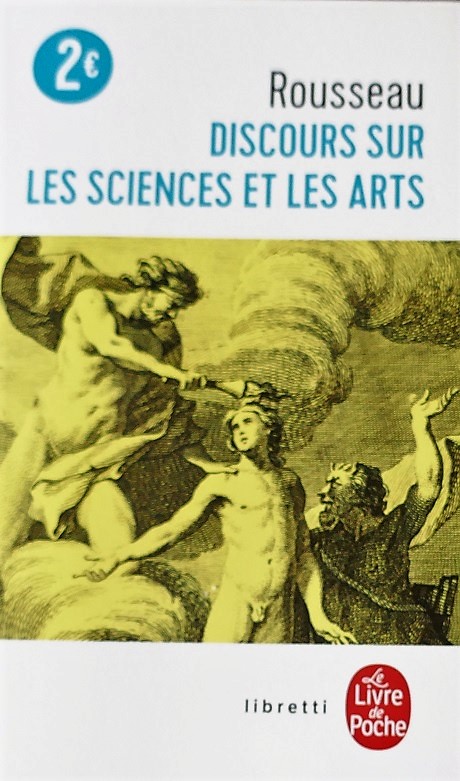















































Vous devez être connecté pour poster un commentaire.