Le Clergé réfractaire. Source : extraits d’une notice de Wikipédia.
Diaporama de 9 photos. Anonyme, Estampe allégorique, Persécution du Clergé Catholique Romain en France, 1791. Source : Cabinet des estampes et dessins de Strasbourg.

« On donne le nom de Clergé réfractaire ou d’Insermentés aux ecclésiastiques hostiles à la Constitution civile du clergé, décret adopté en France par l’Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790 lors de la Révolution française. Une part d’entre eux fut exilée, massacrée ou déportée. Nombre d’entre d’eux entrèrent dans la clandestinité, pour continuer d’assurer, autant que possible, leur apostolat.
Ce clergé réfractaire s’oppose au clergé jureur (dit aussi clergé assermenté ou clergé constitutionnel) qui reconnaît cette Constitution ».

Les débuts de l’antichristianisme révolutionnaire.
« Dès le départ du mouvement, on assiste, en effet, à une série de mesures prises contre l’Église catholique, en France, dès 1789-1790 : suppression de la dîme, interdiction des vœux religieux.
En juillet 1790, est promulguée la Constitution civile du clergé, qui soumet l’Église catholique au pouvoir civil, ainsi que le serment à la Constitution civile, à prêter dans la huitaine. Le roi Louis XVI accepte de promulguer le décret de la Constituante, ce qu’il regrettera amèrement à partir du moment où le pape Pie VI manifeste son opposition.
Le clergé réfractaire désigne alors ce clergé clandestin, ayant refusé de prêter serment. S’ensuit rapidement la répression contre ces prêtres et leurs protecteurs.
En décembre 1791, Louis XVI met son veto à la loi du 29 novembre 1791, qui refuse aux prêtres non-jureurs la liberté de culte, puis, en mai 1792, à la loi du 27 mai qui ordonne la déchéance de la nationalité pour tout réfractaire dénoncé par 20 citoyens ou par un seul en « cas de trouble ».
Malgré l’émeute du 26 juin 1792, il le maintient et quelques arrestations ont déjà lieu, comme le 17 juin 1792, en Maine-et-Loire, le 19 en Côte-d’Or, le 20 à Mayenne ou, encore, le 28 dans le Morbihan.
Cependant, la rupture avec la monarchie du 10 août 1792 va permettre leur application officielle, et les premiers massacres commencent : le 14 juillet, un prêtre est tué à Limoges, neuf dans le Var ; le 15, deux à Bordeaux, dont un rédacteur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le 26 août 1792, les prêtres réfractaires, qu’on peut estimer au nombre de 75 000, doivent quitter la France dans le délai de 15 jours. À cette occasion, le député Isard affirme : il faut renvoyer ces pestiférés dans les lazarets de Rome et de l’Italie
Le phénomène de déchristianisation se caractérise tout d’abord par le fait que ce mouvement a été de très courte durée, et ensuite qu’il ne fut pas organisé par le pouvoir central. Le gouvernement de salut public et la Convention sont hostiles ou en tout cas circonspects face à ce phénomène.
C’est de province que partent les premières initiatives de fermeture d’églises, sous l’égide de représentants en mission ou des Comités de Surveillance. Mais Paris se mobilise presque simultanément. Le 17 novembre 1793, dans une réunion du comité de Salut public, qui est alors le gouvernement effectif de la République, Robespierre dénonce la déchristianisation qui pour lui risque de faire basculer les pays neutres (surtout protestants) dans l’opposition à la France. Le 21 novembre dans un discours au club des Jacobins, il se prononce pour la liberté des cultes. Danton le soutient dans sa lutte contre les Hébertistes qui sont alors les principaux hommes politiques favorables à la déchristianisation. Aussi le 6 décembre, la Convention réaffirme la liberté des cultes, même si le 8 elle décide de na pas rouvrir les églises fermées.
Dès lors, et même si des contre-exemples ont pu exister, soit celui de réfractaires réprimés non pour avoir été réfractaires mais pour avoir commis des actes considérés comme contre-révolutionnaires, la répression des réfractaires prend un caractère paradoxal : elle n’est active que là où la répression s’avère globalement la moins forte.
Ce paradoxe s’accentue de surcroît au cours d’une période très brève : de floréal à thermidor an II. Cette période est encore nettement délimitée à cause de la législation répressive. En effet la Convention, en deux temps, le 26 germinal an II puis le 19 floréal an II, centralise la répression des contre-révolutionnaires à Paris, à quelques exceptions locales près.
Or ces textes, d’une extrême importance, exceptent les réfractaires, ce qui provoque encore une distorsion géographique. Au centre, à Paris, devant le tribunal révolutionnaire, sont jugés désormais les ennemis du peuple, autre version de l’étiquette aristocratique ou contre-révolutionnaire. Dans les départements, et plus particulièrement dans ceux les plus tranquilles, puisque les exceptions locales concernant les textes de germinal et de floréal ne concernent que des départements troublés et frontières où sont conservées des commissions révolutionnaires, le jugement « hors de la loi » des réfractaires est exceptionnellement maintenu.
De fait, l’alliance entre nombre de municipalités manifestement attachées à leurs prêtres et les juges des tribunaux criminels conduit à épargner des réfractaires.
Sous la Terreur, un prêtre réfractaire n’est pas un hors la loi comme les autres. Tout ennemi objectif de la Révolution qu’il paraisse, il bénéficie plus que les autres hors la loi du traitement juridictionnel spécifique de son affaire. L’habileté des juges qui fut en prairial assimilée à la chicane de l’avocature d’Ancien Régime, comme le poids de l’opinion si difficile à évaluer notamment dans les campagnes, infléchissent la répression.
Le 7 mai 1794, Robespierre donne un coup d’arrêt à la déchristianisation. La Convention décrète que le peuple français reconnaît l’existence de l’Être Suprême et de l’immortalité de l’âme. L’existence de l’Être Suprême et l’immortalité de l’âme sont des éléments qui ne sont pas apparus en contradiction avec la façon de vivre le protestantisme au XVIIIe siècle.
Certains pasteurs voyaient dans les cultes révolutionnaires la réalisation d’une partie de leur idéal religieux. A titre d’exemple, on peut citer le conventionnel Lombard-Lachaux d’Orléans : je n’ai jamais prêché que l’amour de la liberté, de l’égalité et de mes semblables ; mon unique désir est de continuer à concourir au bien des sans-culottes.
Après 1794, d’une part et dans un premier temps, le législateur lui-même fait preuve à l’encontre des réfractaires d’une agressivité bien moindre que sous la période « terroriste ». Toute la législation répressive est marquée par les hésitations, les ambiguïtés voire les contradictions d’un pouvoir en réalité engagé dans une impasse à propos de ses relations avec l’Église. Les juges s’engouffreront dans la voie ouverte par cette incohérence. D’autre part et dans un deuxième temps, le pouvoir révolutionnaire lui-même se transforme. L’exécutif et plus particulièrement sa composante ministérielle, absente sous la Terreur, tentent de prendre le relais du législateur dans sa lutte contre les réfractaires. Contrairement aux ambitions terroristes, paradoxalement très proches de l’idéal constituant dans leur absolu légicentrisme, le pouvoir révolutionnaire prend acte sous le Directoire de l’impuissance de la loi. Il tente d’opposer au juge, non des représentants en mission ou des sociétés populaires locales, mais ses ministres ».























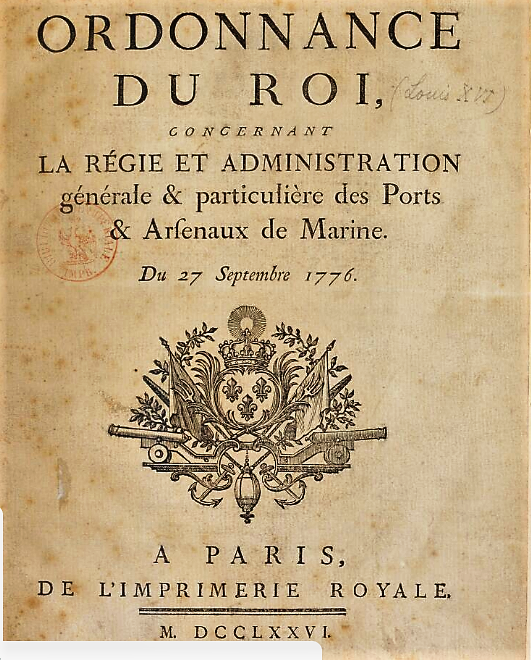
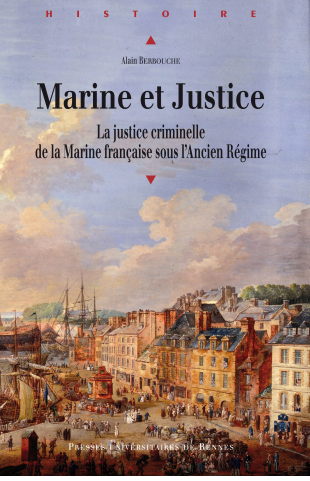
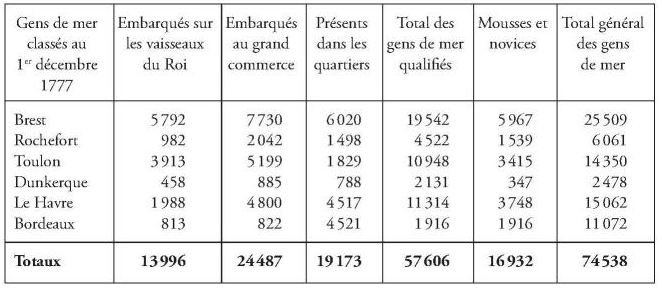



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.